![Foire-de-Paris-2012.jpg]() LA FOIRE DE PARIS 2011 - DU 27 AVRIL AU 8 MAI 2012
LA FOIRE DE PARIS 2011 - DU 27 AVRIL AU 8 MAI 2012
SOUS LE SIGNE DE LA JOIE
La Foire de Paris place la joie au cœur de sa 108e édition : une thématique « happy », en symbiose avec l’événement commercial le plus
festif et convivial d’Europe, véritable référence dans son domaine. Cet immense terrain de jeu et de découvertes de 220 000 m2 ouvrira ses portes pour 12
jours de fête, du 27 avril au 8 mai. Pas moins de 3 400 exposants et marques attendent les 700 000 visiteurs curieux, qui se pressent chaque année dans les trois univers de consommation dédiés :
« Maison et Environnement », « Cultures du Monde » et « Bien-être & Loisirs ». Les mots clés de l’édition 2012 : couleurs, dépaysement, enthousiasme, optimisme,
innovations, plaisirs, découvertes, surprises et inspiration !
Chaque année, la Foire de Paris se renouvelle et met tout en œuvre pour que ses visiteurs vivent un grand moment de fête
et de shopping malin !
Des efforts récompensés, puisque le public de la Foire est fidèle avec 92%1 de visiteurs satisfaits. La Foire de Paris demeure
ainsi la manifestation référente en matière d’art de vivre.
Par ailleurs, elle attire autant d’hommes (51%) que de femmes (49%)1, majoritairement âgés de 35 ans et plus (75%)1.
65% viennent pour découvrir des nouveautés et 61% s’y rendent pour se promener et passer un bon moment1. Sans oublier que 80% des visiteurs réalisent au moins un achat.
Foire de Paris édition 2012
Un véritable hymne à la joie !
Succès des comédies au cinéma, multiplication des flash mobs, engouement pour les ateliers du rire, plaisir du « fait maison »... : la joie, l’optimisme et
l’enthousiasme sont dans l’air du temps.
Toujours dans la tendance, la Foire de Paris, telle une énorme « boîte à joie », ouvre ses portes et diffuse son influence positive dans tous les secteurs de l’art
de vivre à travers des animations, une offre de produits et d’équipements utiles et efficaces et des conseils personnalisés pour un quotidien plus agréable.
Aux côtés des organisateurs, les exposants et partenaires font de cette nouvelle édition un moment festif. Déclinée en plusieurs espaces de jubilation, la Foire de
Paris propose ainsi une immersion totale dans la joie, à l’image d’une friandise géante à croquer sans modération !
UNE ALLÉE CENTRALE HAUTE EN COULEURS
A peine auront-ils franchi les portes de la Foire de Paris, que les visiteurs se sentiront immédiatement imprégnés de l’ambiance festive qui règne sur cette
108e édition. Motifs arlequin, sucres d’orge,
Candy Box et ballons multicolores laissent éclater la joie dans une multitude de matières et de formes. Un accueil tout en légèreté, imaginé et conçu par le studio
Benjamin Poulanges. De quoi donner envie de voir la vie en rose bonbon et de poursuivre le voyage avec le sourire !
HAPPY PARADE
C’est incontestablement l’un des rendez-vous les plus attendus et appréciés de la Foire de Paris. La grande parade réunit environ 300 à
400 personnes par défilé, s’annonçant cette année plus féerique et magique que jamais. De Venise à l’Île-de-France, en passant par Trinidad et les Antilles : 2
heures d’un joyeux charivari, peuplé de créatures fantastiques, de costumes époustouflants et de masques
étincelants pour danser, s’extasier et rêver !
Où ? Départ devant la scène de l’allée centrale Quand ? Les week-ends et jours fériés à partir de 14h15
FESTIVAL TROPIQUES EN FÊTE :
La joie exulte sous le soleil
Pour sa 11e édition, le festival Tropiques en Fête, qui rend hommage aux artistes de l’outre-mer et des îles tropicales, fera
vibrer la Foire de Paris avec 55 spectacles et concerts gratuits live. Une programmation ensoleillée sous le signe de la joie, rythmée par des répertoires variés (tamou- ré, gwo ka, maloya,
biguine, zouk, reggaetown, samba...) et des voix envoûtantes, à l’image de celle de Loalwa Braz, leader charismatique du groupe Kaoma et interprète de la célébrissime Lambada.
Où ? Sur la scène devant le Pavillon 4 Quand ? Tous les jours de 11h à 19h
HAPPY POP NIGHT
Un spectacle de folie en fluo
Paillettes, boucles d’oreilles en plastique fluo, tee-shirts flashy... La nocturne de la Foire de Paris s’annonce Happy ! Une soirée revival, sur le thème des années
80-90, qui bénéficie d’une programmation électrisante. Le groupe « Kid Creole and the Coconuts » viendra ainsi faire vibrer la scène de la Happy Pop Night, suivi de DJ Zebra qui prendra les
commandes des platines pour un mix live euphorisant. De quoi réveiller et faire danser la Foire ! En partenariat avec France Bleu - 107.1.
Où ? Allée centrale - sur la scène Quand ? Le vendredi 4 mai à partir de 20h
HAPPY GARDEN
Déambulation récréative au pays des merveilles
On entre dans ce jardin en sautant à pieds joints ! Ludique et fantasque, le Happy Garden a été pensé par Pierre Alexandre Risser, paysagiste renommé, transformé
pour l’occasion en « chapelier fou ». Un retour en enfance où l’on respire l’odeur des fleurs, où l’on sème de petits cailloux derrière soi, où l’on retrouve ses 10 ans dans les cabanes. Au cœur
de la Foire, le Happy Garden est une parenthèse joyeuse et décalée de 250 m2, véritable remède anti-morosité.
Des ateliers de jardinage sont mis en place pour ceux qui souhaitent se mettre au vert.
Où ? Péristyle du Pavillon 1
HAPPY CUISINE
ATELIERS « SALÉ DÉCALÉ »
Quand la gastronomie met en scène les joies de l’enfance
L’atelier des Chefs, pour cette nouvelle édition, propose des ateliers décalés, détournant contenants et contenus : gourde de tomates aux épices, l’œuf dans l’œuf,
sardine dans sa conserve... Des ateliers pour 10 personnes, d’une durée de 20 minutes chacun, pour partir à la découverte d’une cuisine amusante et originale.
Où ? Pavillon 7/2 - Stand D31
ATELIERS « MANÈGE EN CUISINE »
Un tourbillon de saveurs
Haut de Forme (l’Académie de l’Art de Vivre) et Chef Martial proposent une animation étourdissante avec le « Manège en Cuisine ». Dans un décor pop et gourmand, ces
ateliers culinaires aux noms évocateurs – Bubble Fever, Youpi Whoopie Pies ou encore Bonbons en Folie – encouragent les participants à revisiter desserts et boissons sucrées dans une ambiance
très festive. Des animations délicieusement adulescentes, qui se succèdent toutes les heures.
Où ? Pavillon 5/2 / stand E120
HAPPY CONSEILS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CUISINE À LA PLANCHA Une compétition qui réveille le goût
La seconde édition du Championnat de France de cuisine à la plancha, met cette année le Pays Basque à l’honneur. Sous l’impulsion du chef Alain Darroze, Président de
la Fédération Française de la Cuisine à la Plancha, cette compétition valorise un mode de cuisson authentique, qui respecte les aliments et réveille leur goût. La Foire de Paris reçoit cette
année l’ensemble des phases finales du championnat, des huitièmes jusqu’à la finale, qui se déroulera le 8 mai. Les visiteurs pourront aussi à leur tour s’amuser derrière les fourneaux lors de
sessions quotidiennes d’une heure et demie à 15h30 et 17h. Des stars viendront également s’essayer à ce mode de cuisson lors d’une animation exceptionnelle.
Où ? Pavillon 1 - Stand F004
CONSEILS D’EXPERTS
Des idées utiles pour améliorer son quotidien
Depuis de nombreuses années, la Foire de Paris offre à ses visiteurs l’opportunité de bénéficier gracieusement de nombreux conseils utiles, concrets, délivrés par
des professionnels, sur les problématiques du quo- tidien.
Les experts habitat : Un environnement de salons et produits, propice aux questions concrètes des visiteurs sur leurs projets de rénovation, d’embellissement de leur
habitat et d’amélioration de leur conditions de vie.
-Construction/Rénovation/Agrandissement/Architecture. - Recherches d’un artisan, experts d’un savoir-faire spécifique. - Décoration/ Mise en couleurs/ Gain de place
/ Optimisation d’un bien immobilier à vendre (Home Staging)/ Optimisation du rangement de l’espace intérieur (home organizing ) Les experts de la médiation : Contentieux, litiges : conseils en
négo- ciation constructive des médiateurs professionnels présents sous l’égide delaChambreProfessionnelledelaMédiationetNégociation(CPMN). Les experts « Co » : de nouveaux modes de vie Un
contexte économique difficile favorise souvent le développement de nouveaux modes de vie et les initiatives pertinentes tournées vers le
partage,l’entraide,lamutualisation,laconvivialité,pouroptimiserlequotidien. - Colocation sénior/étudiant. - L’échange de biens,
de services, de savoir-faire.
- Le Coworking : espace de travail partagé. - Le homesitting : un échange de services entre particuliers.
Où ? Pavillon 7/2
ATELIERS DE BRICOLAGE
l’Académie du Bricoleur assurera plus de 60 ateliers de bricolage. Première école de bricolage en France, L’Académie du Bricoleur propose une nouvelle génération de
cours de qualité :pluspratiques,plusconcrets,adaptésàtous,encadrés par des professionnels. En direct de la Foire de Paris, des ateliers gratuits, ludiques, dynamiques, pédagogiques, pour mettre
en confiance et rendre autonomes messieurs, mesdames, débutants ou passionnés.
Où ? Pavillon 6 APPART À PART
L’exposition APPART à PART, portée par le Conseil Général du Bas Rhin, se penche sur la question souvent délicate de l’habitat adapté aux séniors et aux personnes
dépendantes. Organisés autour de 3 thèmes : sécurisation du foyer, bien- être et vie facilitée, ce sont 11 espaces mis en scène qui présenteront produits et équipements innovants. La joie pour
nos séniors n’est-elle pas de pouvoir rester chez soi en toute sécurité et le plus longtemps possible ?
Le Grand Prix de l’Innovation
Les nouveautés de demain en exclusivité
• Rendez-vous incontournable, la 7ème édition du Grand Prix de l’Innovation 2011 présente en avant-première, une vingtaine de
nouveautés en électroménager, cuisine et salle de bains.
Le jury, réunit le 27 avril, présidé par Brigitte Kahane*, a pour mission de désigner les 4 lauréats, dans les catégories technologie, design et éco-conception et un
prix spécial du jury. Le Grand Prix de l’Innovation récompense le « must » en matière de design, de technicité, de confort et de gain de temps.
Cette édition est mise en lumière sur une scène de 200m2 aux couleurs et motifs vintage. Où : Salon Cuisine, salle de bains
& électroménager Pavillon 7 niveau 2
Le Podium Jard’innov’
Les dernières tendances jardin
• S’il y a un domaine où le slow s’impose naturellement, c’est bien le jardin. Qu’il soit balcon, terrasse ou jardin plus classique.
39% des Français pratiquent le jardinage (enquête GIFAM/TNS).
La Foire de Paris 2012 présente les lauréats du Concours Jard’innov’ 2012. Ce podium est une vitrine des innovations en matières de végétaux, de traitements,
d’équipements, d’ameublement et de décoration, de piscine et de spas ... Il réunit les lauréats des 13 catégories, choisis par les professionnels de la distribution et par la presse, parmi les
101 produits mis en compétition.
Organisé par le Groupe J*, ce concours récompense les innovations les plus marquantes de la saison 2011/2012.
A leur côté sont également présentés les Eco Trophées 2010 récompensant les 6 meilleurs éco-produits et démarches environnementales des univers jardin, fleuristerie
et animalerie.
Où : Salon du Jardin - Pavillon 1
Maison & environnement
Etre bien chez soi, on y aspire tous... Adeptes du cocooning, du feng-shui, de la déco écolo, du design solidaire et bien sûr du slow design, nouvelle manière de
penser sa décoration : l’univers Maison & environnement est fait pour vous !
Il rassemble certainement les plus créatifs, les inventeurs les plus étonnants pour proposer au public 1001 idées dans le but d’améliorer son quotidien :
construction et rénovation, énergies nouvelles, cuisines, salles de bains et électroménager, piscine, ... tout y est pour faire de son intérieur et de son extérieur un véritable nid de
bien-être.
Priorité cette année à l’écologie et l’esthétisme ! Le slow design par exemple, en réaction à l’invasion d’objets déco standardisés, soutient la création des objets
uniques, en édition limitée, les objets faits à la main, le recyclage des matériaux ou leur utilisation encourageant le développement durable, l’utilisation de techniques traditionnelles.
Cuisine, salle de bains & électroménager : un concentré d’innovations et de bonnes idées
Plus grand show-room d’Europe, l’espace Cuisine, salle de bains & électroménager s’expose sur 22 000 m2 au sein du
Pavillon 1.
180 exposants leaders du marché (cuisines équipées, salles de bains, gros et petit électroménager) représentent les marques les plus prestigieuses et proposent une
offre unique.
Un must pour découvrir : l’électroménager « green » avec ses « programmes » sprint qui font gagner du temps intelligemment, les équipements design et écolo, les
cuisines de demain où riment bien-être et astuces...
« GRAND PRIX DE L’INNOVATION » : PLACE A l’INNOVATION... EN AVANT PREMIERE
Pour la sixième année consécutive, la Foire de Paris met en lumière une vingtaine de nouveautés lauréates du Grand Prix de l’Innovation. En avant-première, les
dernières nouveautés en cuisine, salle de bains et électroménager privilégiant gain de temps, respect de l’environnement, facilité d’utilisation.
Environnement vintage, couleurs chaudes, parcours simple et ouvert, la Foire de Paris a imaginé un écrin de sérénité pour mieux apprécier cette sélection. PAVILLON
1
Cheminée : créatrice d’ambiance
Au sein du Pavillon 1, le salon Cheminée réunit 45 exposants en cheminées, poêles à bois, inserts, répartis sur 9 000 m2.
Ce salon s’impose comme une référence, avec la présence d’acteurs majeurs et une offre produits la plus vaste.
Cheminée nomade ou 100% écologique, extincteur design,... l’hiver sera slow au coin de la cheminée ! PAVILLON 1
Construction & rénovation ‘bâtiment’ : le bâtiment à l’heure de l’éco-construction
Symbiose des tendances les plus actuelles et des innovations les plus performantes pour répondre aux nouveaux modes de vie des consommateurs, le salon Construction
& rénovation ‘bâtiment’, implanté au sein du Pavillon 1, présente 170 exposants sur plus de 10 000 m2.
Échantillon représentatif des secteurs du bâtiment – éco-construction, immobilier, matériaux-isolation cloisonnement, menuiseries extérieures-intérieures,
revêtements et décoration, sécurité et protection, organismes professionnels et d’information – le salon apporte les réponses à tous les projets de construction, de rénovation, de travaux et
d’habitat.
Le linoléum (antibactérien) renait, le stratifié se clipse, les panneaux architecturaux se font translucides, la cotte de maille, le liège, le bois ou la terre cuite
reviennent en force : cap sur une maison verte et tendance avec des matériaux écolo ou durables. PAVILLON 1
Construction & rénovation ‘énergétique’ : un salon HQE
Au sein du Pavillon 2 sur 17 000 m2, 90 exposants présentent une offre large et diversifiée pour améliorer les performances
énergétiques de l’habitat.
L’occasion de rencontrer les acteurs majeurs des différents secteurs : chauffage traditionnel, solaire, éolien, photovoltaïque, climatisation, traitement de l’eau et
géothermie. Mais aussi une large offre en matière d’isolation et de menuiserie extérieure.
Du radiateur intelligent au chauffe-eau thermodynamique, c’est sans aucun doute un salon source d’énergies ! PAVILLON 7 niveau 3
Véranda : un espace en pleine lumière
Au sein du pavillon 2 niveau 2 un univers intégralement dédié à la véranda, pièce slow par excellence. Des systèmes d’isolation innovants ont permis de faire de
cette « pièce en plus » un véritable lieu de vie en toute saison. Jardin d’hiver, pièce fraîcheur l’été, la véranda se prête à toutes les interprétations et les rêveries.
Modulable à souhait, de 20 m2 en moyenne, de style victorien, asymétrique, classique ou design, en aluminium, en pvc, en acier
ou en bois, la véranda permet de s’évader du quotidien, de s’offrir du temps pour lire, se reposer, s’isoler ou recevoir dans un cadre atypique.
A découvrir les dernières tendances, notamment l’éco-véranda. PAVILLON 1
Jardin : quand la déco « jardine »
16 000 m2, 120 exposants leaders du secteur : c’est le salon Jardin !
Mobilier, décoration et équipements extérieurs, barbecue, motoculture et outillage, préparation et entretien : ode slow à l’outdoor-indoor très attendu par le
consommateur en quête de nature et préoccupé d’environnement. Relaxant, épuré, convivial, aquatique, design, sauvage, graphique, exotique, baroque, minimaliste, ... le jardin est un terrain de
jeu infini.
Un jardin slow ? En 2011, bienvenue dans l’ère du slacking : l’art de s’affaler avec élégance, de s’initier à une paresse constructive ! On s’enfonce dans du
moelleux : poufs, poires, plaids aux coloris vivifiants. Sous la slow attitude, teck et palissandre sont de rigueur. Lanternes, photophores, bougeoirs extérieurs, bougies d’ambiance : la touche
finale pour un cadre qui invite à prendre soin de soi, à prendre le temps... au jardin tout simplement.
Au cœur du salon, le podium Jard’Innov’ avec ses animations et ses espaces Slow pour découvrir les treize nouveautés dédiées au jardin et les produits de jardinage
récompensés par les Eco’Trophées. PAVILLON 31
Piscine : à chacun son bassin
Sur 12 000 m2 et avec plus de 50 exposants au sein du Pavillon 3, le salon piscine fait la part belle aux produits high-tech,
esthétiques et respectueux de l’environnement. Reflet des dernières innovations, vitrine des grandes marques et des réseaux, le salon offre un large panel de solutions, de la piscine hors sol à
la piscine enterrée avec abris. Sans oublier le spa, le sauna ou le hammam.
Près d’un million et demi de piscines en France : le parc a doublé en 10 ans !*
Démocratisée, elle est considérée comme une source de bien-être à domicile ainsi qu’un moyen de valoriser son patrimoine immobilier. Les bassins s’affranchissent de
la forme rectangulaire traditionnelle pour offrir des proportions et des formes adaptées aux souhaits et aux budgets de chacun.
Minipiscines, bassins XS, couloirs de nage, piscines aux formes libres, piscines naturelles, personnalisation du liner, piscines à variations chromatiques,
surveillance du bassin à distance, spa éco-citoyen : plongez, savourez !
PAVILLON 1
Image et son : espace zen pour innovations technologiques
Implanté au sein du Pavillon 7, sur 2 400 m2, le salon Image et son est le seul salon grand public où les visiteurs peuvent
venir découvrir et tester le meilleur des nouvelles technologies en matière de hifi, de home cinéma, de photo, de musique, ...
20 exposants présentent les dernières innovations du secteur avec une large gamme de produits.
Une édition 2011 sans nul doute placée sous le signe de la tablette tactile ! PAVILLON 2 niveau 2 et 3
Ameublement & décoration : le plus grand show room dédié à l’univers maison
Implanté au sein du Pavillon 7, réunis sur 40 000 m2, 300 exposants – des marques leaders aux artisans indépendants –
proposent une offre large et diversifiée pour meubler et décorer son intérieur : meubles, salons, rangements, literie, luminaires, linge de maison, galeries d’art, tapis, arts de la table, objets
de décoration. Le rendez-vous de toutes les tendances et de tous les styles avec 1001 idées pour relooker sa maison.
À l’ère et à l’heure du slow, l’intime et la cohabitation sont les 2 tendances de l’année : mieux vivre à deux ou à plusieurs dans les habitats dans un maximum de
confort et de praticité. C’est dans ce salon que le « Slow Hôtel » ouvre ses portes.
PAVILLON 2 niveau 2 et 3
Bien-être & loisirs :
Forme & bien-être : prendre du temps pour soi
Un salon unique entièrement dédié aux femmes : beauté, remise en forme et diététique font de ce salon le rendez-vous de toutes les femmes en quête d’épanouissement
personnel.
Les exposants proposent une offre complète de produits de bien-être, de programmes anti-âge, font découvrir les dernières tendances manucure, proposent des conseils
relooking, des astuces pour avoir de beaux cheveux, des leçons de maquillages, mais aussi des conseils avisés pour les futures et jeunes mamans ... Telle une immense beauty room, le salon Forme
& bien-être est le repère de la « pretty woman » qui souhaite prendre du temps pour elle !
PAVILLON 7 niveau 1
Accessoires de mode : à chacun son it-bag
L’accessoire... un petit rien qui fait souvent tout ! Bijoux, chapeaux, petite maroquinerie... pièce unique ou accessoire, originaux, arty ou chics.
Un salon où le visiteur flânera à son rythme à la découverte des dernières tendances, de l’accessoire indispensable pour une touche stylée. PAVILLON 5 niveau
2
Les ateliers créatifs : créer, inventer, oser...
Activités « slow » par excellence, les loisirs créatifs demandent temps et patience.
Ce nouveau salon s’adresse aux adeptes du « do it yourself » : néophytes à la recherche d’une nouvelle passion ou aguerris venus se perfectionner et trouver de
nouveaux produits, de nouvelles idées.
Véritable lieu d’inspiration et d’envie, à la fois coloré, ludique et tendance, s’offre au visiteur un éventail d’idées de loisirs créatifs, des initiations, des
ateliers,... ici on coud, on tricote, on peint, on patine, on customise...
C’est le moment de se mettre au scrapbooking et à l’origami, arts de patience, de customiser avec du masking tape et de s’initier à la récupération, au recyclage et
au détournement d’objets ... PAVILLON 5 niveau 2
Les démonstrateurs : vu, convaincu !
Un salon plein d’astuces et de produits malins pour un public à l’affût des dernières nouveautés qui facilitent le quotidien, lui permettent de gagner du temps pour
mieux apprécier ses plages de détente.
Les démonstrateurs : une offre complète en outillage, droguerie, quincaillerie, matériel de chantier, électricité, articles de bureaux et gadgets, produits
d’entretien auto/moto/vélo, équipement pour animaux et petit ménager.
Des produits efficaces, simples, astucieux et des séances d’initiation et de démonstration font de ce salon un passage obligé ! PAVILLON 6
Résidences & loisirs de plein air : en symbiose avec la nature
Éco-tourisme, sport nature, slow travel sont au rendez-vous de l’année 2011.
4 200 m2 en extérieur à la découverte de nouveautés et activités de 40 exposants et marques des secteurs du camping-car,
caravanes, mobil-homes, chalets, toiles de tente et auvents, résidences de camping et bases de loisirs, véhicules de loisirs sans permis, 2 roues, activités sportives de plein air, sports
nautiques, vêtements et articles de sport, fédérations et institutionnels.
ESPLANADE
Cultures du monde
Richesses du Monde : dépaysement garanti
De l’Asie à l’Amérique du sud, de l’Océanie à l’Afrique, plus de 50 pays viennent sur le salon Richesses du Monde partager la diversité et les trésors de leur
patrimoine artisanal, culturel et culinaire.
Les visiteurs seront accueillis par des peuples chaleureux dans une ambiance de marchés locaux : une occasion unique de découvrir les cultures, les objets de
décoration, la mode, les accessoires de beauté ethnique et les spécialités culinaires de plus de 300 exposants.
Au programme : artisanat local, créateurs, gastronomie d’ailleurs, marchés du monde, trésors ethniques, beauté, folklore et ambiance festive rythment et enivrent
toutes les communautés.
PAVILLON 4
Terre des Tropiques : tout en couleurs et en saveurs
Escale slow au Pavillon 4 sur les archipels ! Sur 8 000 m2 d’exposition, Terres des Tropiques est le salon le plus important
dédié aux îles tropicales et à l’outre-mer dont il révèle les couleurs, les saveurs, les merveilles et les talents.
Plus de 200 exposants réunis sur 5 secteurs (tourisme, artisanat, gastronomie, mode & beauté, culture) qui constituent le point le plus fréquenté de la Foire de
Paris avec 67% de visiteurs !
Ici, c’est le moment de se mettre en mode zouk, fleurs de tiaré autour du cou tout en savourant lentement rhum arrangé, boudin créole et accras.
Au programme : shopping malin dans une ambiance exotique, rencontres chaleureuses, dégustations de spécialités, découverte de destinations, artisanat local,
richesses du sol et des mers, démonstrations de coiffures « afro » ou de tatouages polynésiens... PAVILLON 4
Evénement incontournable du salon : LE FESTIVAL TROPIQUES EN FÊTE
Un festival qui rend hommage aux talents de l’Outre- Mer et des îles tropicales. Au total : 60 spectacles lives musicaux gratuits durant 11 jours pour vibrer et
danser à son rythme !
Temps fort du Festival : sa nocturne et son concert inédit LE rendez-vous festif de la communauté comme des amoureux des îles.
Artisanat & métiers d’art : vitrine exceptionnelle du savoir-faire artisanal
Un salon pour prendre le temps de découvrir, d’observer la richesse du patrimoine artisanal français et européen sur 5 000 m2.
Conçu dans la volonté de soutenir et de valoriser la création, il est le rendez- vous par excellence de tous les Parisiens souhaitant dénicher un objet fait main, une œuvre inédite, ou encore une
trouvaille des plus originales !
Partenaire du salon, Ateliers d’Art de France soutient et valorise la création et les savoir-faire de toutes les régions de France. Le Village Ateliers d’Art de
France accueille 50 représentants des métiers d’art sur le salon.
Au programme : rencontres avec des verriers, des tisserands, des ferronniers, découverte de pièces uniques, ... Pavillon 5 niveau 1
Vins & gastronomie : prendre le temps d’apprécier et de déguster
12 000 m2 et plus de 200 exposants réunis au Pavillon 5 niveau 2 pour redécouvrir le bonheur de passer à table !
Prendre le temps de déguster, de choisir, d’être à l’écoute de ses sensations gustatives, de retrouver le plaisir de goûter, manger local, varier les aliments,
découvrir des traditions culinaires, cuisiner, partager des produits sains et du terroir, échanger des recettes originales dans la bonne humeur : une édition à découvrir avec les « Pauses
Cuisines ».
Au programme : dégustations, vins, restauration régionale, spécialités européennes, matériel de cave, ustensiles de cuisine, écoles de cuisine, « slow » ateliers,
produits sains et malins pour gagner du temps,... PAVILLON 7 niveau 3
Informations pratiques :
DATES & HORAIRES :
– La Foire de Paris 2012 se tiendra à Paris Porte de Versailles du vendredi 27 avril au mardi 8 mai 2012
– Horaires d’ouverture - De 10h à 19h sans interrup- tion
– Nuit de la Foire - Le vendredi 4 mai jusqu’ à 23h
TARIFS :
– Plein tarif individuel : 12 €
– Pass2jours:18€ –Tarif enfant (7à14ans) :7€
– Entrée gratuite pour les enfants - de 7 ans
BILLETS EN VENTE :
www.foiredeparis.fr et chez les revendeurs.
VENIR AU SALON :
– En transport en commun :
• Métro Ligne 12 : Station Porte de Versailles.
• Ligne 8 : Station Balard.
– Tramway : Ligne T2/T3 arrêt Porte de Versailles.
– Bus : Ligne 80 arrêt Porte de Versailles.
– En vélib’ : Station 15049 - 2 Rue Ernest Renan Station 15107 - 42 Boulevard Victor Station 15061 - 12 Square Desnouettes
– En taxis: Des stations de taxis à la Porte de Versailles : Boulevard Lefèbvre et Boulevard Victor Nouvelle organisation des stations et un numéro unique d’appel :
01 45 30 30 30 (prix d’une communication locale).
– En voiture : Depuis les autoroutes A1, A3, A14, A15 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Ouest.
• Depuis les autoroutes A3, A4, A6, A10 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Sud.
• Depuis le périphérique : Sortie Porte de Versailles. Les parkings du Parc des expositions sont situés aux
portes C, F, et R.
SERVICES VISITEURS :
– Espace enfants – Pavillon 5 niveau 1 : Les visiteurs peuvent laisser leurs enfants âgés de 4/8 ans deux heures maximum auprès de nos animateurs pour découvrir et
participer aux différents Ateliers de jeux.
– Nurserie : Tout est prévu pour ne rien changer au rythme des bébés agés de 0 à 3 ans : coin repas, tables à langer, coin allaitement, jeux, prêt de
poussettes.
 Les Journées de l’Éolien 2012 - « mon éolienne et moi »
Les Journées de l’Éolien 2012 - « mon éolienne et moi »
 Produire son eau chaude et son électricité solaires – Thierry Gallauziaux - David
Fedullo
Produire son eau chaude et son électricité solaires – Thierry Gallauziaux - David
Fedullo LES JOURNEES D’ARCHITECTURES À VIVRE 14/15/16/17 ET 22/23/24 JUIN 2012
LES JOURNEES D’ARCHITECTURES À VIVRE 14/15/16/17 ET 22/23/24 JUIN 2012
 Gullivert
2011-2012 - Le guide pratique du savoir vert
Gullivert
2011-2012 - Le guide pratique du savoir vert
 8e édition de « La Nuit européenne des musées » - Samedi 19 mai 2012
8e édition de « La Nuit européenne des musées » - Samedi 19 mai 2012
 Les Journées nationales de l’Archéologie « De la fouille... au musée » Du 22 au 24 Juin
2012
Les Journées nationales de l’Archéologie « De la fouille... au musée » Du 22 au 24 Juin
2012 Festival des Architectures Vives à Montpellier-2012- DU 13 au 17 juin...
Festival des Architectures Vives à Montpellier-2012- DU 13 au 17 juin...





 Comprendre la formation et la dérive des continents
Comprendre la formation et la dérive des continents
 © Droits
réservés
© Droits
réservés
 CIMA
DA CONEGLIANO - MAÎTRE DE LA RENAISSANCE VÉNITIENNE - 5 avril au 15 juillet 2012
CIMA
DA CONEGLIANO - MAÎTRE DE LA RENAISSANCE VÉNITIENNE - 5 avril au 15 juillet 2012
 Giambattista Cima da Conegliano (1459-1517/8) - Musée des Beaux-Arts, Strasbourg, France
Giambattista Cima da Conegliano (1459-1517/8) - Musée des Beaux-Arts, Strasbourg, France
 L’incrédulité de
saint Thomas et l’évêque saint Magne, vers 1504-1505, Venise, Galleria dell’Academia © Giovanni C.F. Villa, Centro di Arti Visive, Università degli Studi di Bergamo
L’incrédulité de
saint Thomas et l’évêque saint Magne, vers 1504-1505, Venise, Galleria dell’Academia © Giovanni C.F. Villa, Centro di Arti Visive, Università degli Studi di Bergamo
 Cima da
Conegliano, Endimione dormiente. Parma, Galleria Nazionale
Cima da
Conegliano, Endimione dormiente. Parma, Galleria Nazionale
 Cima da
Conegliano, San Girolamo penitente nel deserto, Budapest
Cima da
Conegliano, San Girolamo penitente nel deserto, Budapest
 Pensée du Jour
Pensée du Jour Ductal® en façade = Des solutions pour l’ITI ou l’ITE
Ductal® en façade = Des solutions pour l’ITI ou l’ITE
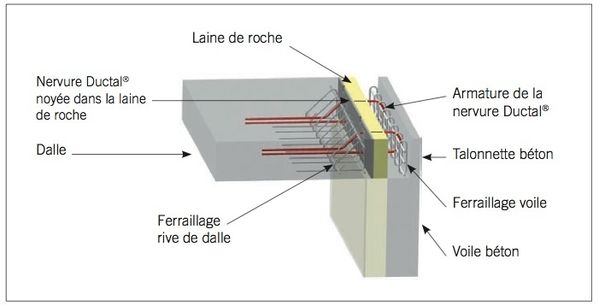










 Bourses
pour jeunes chercheurs et plasticiens, pour l’année 2012 attribuer par La Fondation Le Corbusier
Bourses
pour jeunes chercheurs et plasticiens, pour l’année 2012 attribuer par La Fondation Le Corbusier
 LA FOIRE DE PARIS 2011 - DU 27 AVRIL AU 8 MAI 2012
LA FOIRE DE PARIS 2011 - DU 27 AVRIL AU 8 MAI 2012
 Sur les
traces de Van Gogh, entre mythe et vérités - Jeudi 10 mai 21.40 – France 5
Sur les
traces de Van Gogh, entre mythe et vérités - Jeudi 10 mai 21.40 – France 5
 Congo : le rafiot de l’enfer - Mardi 8 Mai 15.05 - France 5
Congo : le rafiot de l’enfer - Mardi 8 Mai 15.05 - France 5
 Consommateurs pris au piège -
Dimanche 13 mai 20.35 -
Consommateurs pris au piège -
Dimanche 13 mai 20.35 - 24ème BATICUP
! Du 28 juin au 1er juillet 2012 à Bénodet
24ème BATICUP
! Du 28 juin au 1er juillet 2012 à Bénodet Aux arts citoyens III - Jeudi 17 mai 21.40 -
Aux arts citoyens III - Jeudi 17 mai 21.40 -