![TVA]() Après le crédit d’impôt, quoi
d’autres ???
Après le crédit d’impôt, quoi
d’autres ???
Après avoir présenté le crédit d’impôt durable, « Quid du crédit d’impôt 2012 pour financer la performance énergétique de son logement… » et ayant présenté dernièrement l’adoption par le parlement le 21 décembre dernier le passage de la TVA 5,5 % à 7 % s’insérant dans le
cadre visant à la réduction du déficit public, « Au 1er janvier la TVA de 5,5 à 7 % … », la TVA réduite s’applique aussi
sur certains travaux entrepris dans les logements de plus de deux ans donnent droit à un taux réduit de TVA.
Cette taxe porte sur l’achat de matériel et les frais de main d’œuvre. Son taux était de 5,5 % en 2011 et passe à 7 % pour les travaux facturés à compter du 1er janvier 2012.
A notre qu’une dérogation peut être obtenue pour le taux de 5,5 %. Le taux de 5,5 % reste applicable aux travaux qui ont fait l’objet d’un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20
décembre 2011 et d’un acompte encaissé avant cette date.
La TVA à taux réduit ne porte pas sur les travaux qui, sur une période de 2 ans, remettent à l’état neuf à plus des 2/3 chacun des éléments de second œuvre, planchers non porteurs, installations
sanitaires et de plomberie, fenêtres et portes extérieures, installations électriques, cloisons intérieures, systèmes de chauffage, ou plus de la moitié du gros œuvre.
Conditions d’obtention :
- propriétaire occupant, bailleur ou syndicat de propriétaires,
- locataire, occupant à titre gratuit,
- une société civile immobilière.
Le logement faisant l’objet des travaux est :
- achevé depuis plus de 2 ans,
- une maison individuelle ou un appartement,
- résidence principale ou secondaire.
Les autres conditions impératives :
- seuls les travaux et équipements facturés par une entreprise sont concernés,
- l’entreprise qui vend le matériel et en assure la pose applique directement le taux réduit de TVA.
Quelles applications ?
Pour bénéficier du taux réduit de TVA il faut réaliser :
- des travaux d’isolation thermique ;
- l’amélioration de votre système de chauffage :
• régulation,
• changement de chaudière,
• installation d’un chauffage au bois,
• installation d’un système de chauffage ou d’eau chaude solaires,
• installation d’une pompe à chaleur pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ;
- l’installation d’un système de production électrique par énergies renouvelables : photovoltaïque, éolien, hydraulique,
- en copropriété, également l’amélioration du système de chauffage.
Exception : TVA réduite à 5,5%
• Pour les abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseau.
• Pour la fourniture de chaleur distribuée par réseau lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de sources d’énergies renouvelables ou de récupération (biomasse, géothermie, déchets,
etc.).
Pas de TVA réduite
Depuis le 1er janvier 2010, les systèmes de climatisation ne bénéficient plus du taux réduit de TVA. Ils sont donc taxés au taux normal.
![eco pret]()
Autre coup de pouce très utile, l’éco-prêt à taux zéro, issu d’un engagement du Grenelle Environnement. Il permet de financer des travaux de rénovation énergétique sans faire d’avance de
trésorerie et sans payer d’intérêts. Un prêt sans intérêts disponible selon deux options possibles, soit un bouquet de travaux, soit des travaux aboutissant à une amélioration de la performance
énergétique globale du bâtiment. Il est possible d’y inclure aussi les travaux induits par les travaux éligibles (peinture, électricité...) et les frais d’études.
Obtention de l’éco-prêt :
- propriétaire occupant, bailleur ou une société civile
- éventuellement en copropriété.
Le logement est :
- une résidence principale ou un logement loué ou engager à louer en tant que résidence principale,
- une maison individuelle ou un appartement,
- construit avant le 1er janvier 1990, et aussi, si le choix est d’améliorer la performance globale, après le 1er janvier
1948.
Le prêt est attribué :
- une seule fois par logement
- pour des matériaux et des équipements nécessaires à la réalisation de travaux d’amélioration énergétique du logement, qui répondent à des exigences minimales, et fournis et posés par des
professionnels,
- pour des travaux qui doivent être réalisés dans les deux ans qui suivent l’obtention du prêt,
- en complément, pour financer
• les frais liés à la maîtrise d’œuvre (par exemple, un architecte) et d’étude thermique,
• les frais éventuels d’assurance maîtrise d’ouvrage,
• tous les travaux induits, réalisés par un professionnel, indissociables des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique.
Le cumul avec d’autres aides est possible, pour les mêmes travaux :
- avec le crédit d’impôt développement durable si les revenus du foyer fiscal demandeur sont inférieurs à 30 000 € l’avant-dernière année précédent l’offre de prêt, et ceci pour les offres émises
à compter du 1er janvier 2012,
- avec un prêt complémentaire développement durable.
A noter que : L’éco-prêt à taux zéro peut aussi être attribué pour la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif (l’éco-prêt «assainissement» ne peut être cumulé avec
l’éco-prêt «travaux»). Pour en savoir plus, adresser au service public d’assainissement non collectif (SPANC) de sa mairie.
Montant et durée :
Le montant du prêt couvre l’intégralité de travaux d’économie d’énergie, ainsi que les services ou travaux associés qui leur sont directement liés.
Pour les bouquets de 2 travaux :
Le montant du prêt est de 20 000 € maximum. Sa durée de remboursement est limitée à 10 ans (cette durée concerne aussi les travaux de réhabilitation des dispositifs d’assainissement individuel).
Pour les bouquets de 3 travaux et l’amélioration de la performance globale :
Le montant du prêt est de 30 000 € maximum. Sa durée maximale passe de 10 à 15 ans en avril 2012. Elle peut être réduite à 3 ans à votre demande.
Attention, les travaux constitutifs d’un bouquet de travaux sont un peu différents dans le cas du crédit d’impôt développement durable (majoration du taux).
Bouquet travaux :
2 travaux ou 3 travaux, au moins à réaliser, dans les catégories de travaux énoncées dans le tableau suivant. Les matériaux et les équipements éligibles doivent répondre aux normes en vigueur et
présenter les caractéristiques et performances précisées dans le tableau.
|
Catégories de travaux éligibles
|
Caractéristiques et performances
|
|
1- Isolation de la toiture
Les travaux doivent conduire à isoler l’ensemble de la toiture
|
|
isolants des planchers de combles perdus
|
R ≥ 5 m2 K/W
|
|
isolants des rampants de combles aménagés
|
R ≥ 4 m2 K/W
|
|
isolants des toitures terrasses
|
R ≥ 3 m2 K/W
|
|
2- Isolation des murs donnant sur l’extérieur
Les travaux doivent conduire à isoler au moins 50 % de la surface des murs donnant sur l’extérieur
|
|
isolants (par l’intérieur ou par l’extérieur)
|
R ≥ 2,8 m2 K/W
|
|
3- Remplacement des fenêtres et des portes-fenêtres donnant sur l’extérieur et remplacement éventuel des portes donnant sur l’extérieur
Les travaux doivent conduire à isoler au moins la moitié des parois vitrées du logement, en nombre de fenêtres
|
|
fenêtre ou porte-fenêtre
|
Uw ≤ 1,8 W/m2 K
|
|
fenêtre ou porte-fenêtre munie de volets
|
Ujn ≤ 1,8 W/m2 K
|
|
seconde fenêtre devant une fenêtre existante
|
Uw ou Ujn ≤ 2,0 W/m2 K
|
|
porte donnant sur l’extérieur (uniquement si réalisé en complément des fenêtres)
|
Uw≤1,8 W/m2 K
|
|
réalisation d’un sas donnant sur l’extérieur (pose devant la porte existante d’une 2e porte)-(uniquement si réalisé en complément des fenêtres)
|
Uw ou Ujn ≤ 2,0 W/m2
|
|
4- Installation ou remplacement d’un système de chauffage (associé le cas échéant à un système de ventilation performant) ou d’une production d’eau chaude sanitaire
|
|
chaudière + programmateur de chauffage
|
à condensation ou basse température, mais seulement en bâtiment collectif quand l’installation d’une chaudière à condensation est impossible)
|
|
PAC* chauffage + programmateur de chauffage
|
CoP≥3,3
|
|
PAC* chauffage + ECS + programmateur de chauffage
|
CoP≥3,3
|
|
5- Installation d’un système de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable
|
|
chaudière bois + programmateur
|
classe 3 au moins
|
|
poêle à bois, foyer fermé, insert de cheminée intérieure
|
rendement ≥ 70%
|
|
6 - Installation d’un système de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable
|
|
|
capteurs solaires
|
certification CsTBat, solar Keymark ou équivalente
|
L’amélioration de la performance énergétique globale ouvre l’éligibilité à l’éco-prêt. Les travaux doivent permettre d’atteindre une certaine performance énergétique, modulée selon l’implantation
géographique et définie par une étude thermique. Les exigences sont les suivantes :
|
Consommation du logement avant travaux
|
Résultat exige
|
|
Plus de 180 kWh/m2.an*
|
au plus 150 kWh/m2 an*
|
|
Moins de 180 kWh/m2.an*
|
au plus 80 kWh/m2 an*
|
· modulé selon la localisation du logement (zone climatique et altitude).
Après avoir identifié les travaux nécessaires, faire réaliser des devis et remplir le formulaire type « devis ». S’adresser à sa banque muni de ce formulaire et des devis
relatifs aux travaux retenus.
Une fois le prêt accordé, faire réaliser les travaux dans les 2 ans qui suivent. Il faudra retourner voir la banque à l’issue des travaux, muni du formulaire type « factures » accompagné de
toutes les factures.
Les formulaires type « devis » et type « factures », ainsi que leur guide d’utilisation, sont téléchargeables sur le site ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet/eco-pret-a-taux- zero
L’éco-prêt à taux zéro, s’il n’est pas suffisant pour couvrir l’intégralité du montant des travaux, peut être complété par un ou plusieurs prêts destinés à l’amélioration de l’habitat, voir la
suite :…
Aides de l’Anah, aides des collectivités territoriales, prêts bonifiés... Les organismes et instances qui peuvent aider financièrement à la réalisation d’un projet d’amélioration énergétique d’un
logement sont nombreux. Une petite revue de détail s’impose, mais les informations plus complètes seront prises auprès de leurs instances.
![anah-subvention-proprietaire-particulier]()
L’Anah, en direction des propriétaires :
L’Anah octroie des aides destinées :
- à lutter contre l’habitat indigne,
- à adapter le logement à la perte d’autonomie,
- à lutter contre la précarité énergétique,
- à favoriser la réalisation de travaux importants par les bailleurs privés qui s’engagent à respecter des plafonds de loyers - et à privilégier la maîtrise des consommations d’énergie,
- à traiter les copropriétés dégradées.
Dans les secteurs où existent des opérations d’amélioration d’habitat (Opération programmée d’amélioration de l’habitat ou OPAH, Programme d’intérêt général ou PIG), mises en place par une
collectivité et l’Anah, les propriétaires peuvent bénéficier d’une assistance gratuite pour leurs travaux d’amélioration de l’habitat (voir www.lesopah.fr).
Etre propriétaire occupant (sous condition de ressources) :
L’Anah apporte des subventions: l’aide complémentaire du programme « Habiter mieux » peut aider à améliorer la performance énergétique du logement. Elle complète les aides de l’Anah pour
l’amélioration des logements des propriétaires occupants aux ressources modestes (20 ou 35 % du montant total des travaux). Pour en bénéficier, il faut être accompagné par un organisme reconnu,
réaliser des travaux qui permettent d’améliorer d’au moins 25% la performance énergétique du logement et être situé dans un territoire où un contrat local d’engagement contre la précarité
énergétique a été conclu. L’aide complémentaire est une prime forfaitaire d’un montant minimum de 1600 € (pouvant être majorée jusqu’à 2100 €).
Etre propriétaire bailleur :
Pour bénéficier d’une aide de l’Anah dès lors que les travaux, indépendamment des améliorations qu’ils génèrent, permettent d’atteindre un certain niveau de performance énergétique (au moins le
niveau «E» sur l’étiquette énergie, et même « D » ou « C » en fonction de choix locaux). C’est le principe d’éco-conditionnalité des aides.
www.anah.fr
Des aides liées à votre lieu de résidence :
Pour un certain nombre de travaux d’amélioration de la performance énergétique, certaines régions, départements, communes, intercommunalités... peuvent accorder des aides, comme par exemple
l’exonération temporaire de la taxe foncière.
Plusieurs organismes tiennent à jour la liste des aides des collectivités territoriales :
- les adil (agences départementales d’information sur le logement) mènent tous les ans une enquête pour recenser les aides aux particuliers en matière d’accession à la propriété, d’amélioration
de l’habitat, de maîtrise des dépenses d’énergie et d’adaptation des logements au handicap et au vieillissement ;
- le Cler (Comité de liaison énergies renouvelables) liste les aides des collectivités territoriales pour les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie. Contactez ces organismes et
l’Espace le plus proche de chez vous pour savoir comment en bénéficier.
Site www.anil.org , Sitewww.cler.org
Exonération temporaire de la taxe foncière :
Conditions d’obtention
La commune où se situe le logement a pris la délibération d’exonération de la taxe foncière. Propriétaire d’un logement et faire réaliser des travaux d’amélioration énergétique donnant droit au
crédit d’impôt développement durable.
Le logement a été achevé avant le 1er janvier 1989, mais certains logements neufs peuvent aussi en bénéficier.
Le montant des travaux est supérieur :
- à 10 000 € par logement au cours de l’année précédant l’application de l’exonération,
- ou à 15 000 € par logement au cours des 3 années précédant l’application de l’exonération.
Application
On peut être exonéré du paiement de 50 ou 100 % de la taxe foncière, pendant 5 ans, à compter de l’année suivant celle du paiement total des travaux. À l’issue de ces 5 ans, on ne peut bénéficier
à nouveau de l’exonération avant 10 ans.
Les démarches
Se renseigner auprès de sa mairie. Pour bénéficier de l’exonération, faire les démarches nécessaires auprès du centre des impôts de la commune où se situe le logement.
Site vosdroits.service-public.fr
Des prêts pour l’amélioration énergétique :
Les prêts sur le Livret développement durable :
Avec la mise en place du Livret de développement durable depuis le 1er janvier 2007, les banques doivent proposer des prêts spécifiques pour financer les travaux d’amélioration de la performance
énergétique des logements.
Les travaux éligibles sont les mêmes que pour le crédit d’impôt, mais les prêts couvrent tous les frais, y compris l’installation. Ils peuvent être demandés pour une résidence principale comme
pour une résidence secondaire, en individuel ou en collectif. Les conditions du prêt sont fixées par l’organisme financier. Il lui faut remettre une fiche type, remplie avec le ou les
professionnels devant réaliser les travaux. Cette fiche type est téléchargeable sur le site ecocitoyens.ademe.fr/financer- mon-projet/renovation/eco-pret-et-autres.
Le prêt d’accession sociale (PAs)
Son obtention dépend des ressources, de la région où habite le demandeur et du nombre de personnes composant le ménage. Se renseigner sur ce prêt auprès des établissements de crédit, dans le
cadre de réaliser des travaux d’amélioration ou d’économies d’énergie. Ce prêt peut couvrir jusqu’à 100 % de leur coût.
Le prêt d’épargne logement
Dans le cadre d’un plan d’épargne logement ou un compte épargne logement arrivé à échéance, on peut bénéficier d’un prêt pour l’achat ou la rénovation de l’habitat.
Le prêt à l’amélioration de l’habitat
Dans le cas d’allocations familiales et sous conditions de ressources, on peut bénéficier de ce prêt qui concerne, entre autres, les travaux d’amélioration et d’isolation thermique. Il peut
couvrir 80 % de leur montant (montant plafonné). Pour plus d’informations, s’adresser à la caisse d’allocations familiales (CAF). .
Les prêts des collectivités territoriales, des caisses de retraites...
Certains de ces organismes peuvent proposer des prêts intéressants ou des offres particulières. Se renseigner auprès d’eux pour plus d’informations.
Les prêts des distributeurs d’énergie, des professionnels du chauffage et de l’isolation
La plupart des distributeurs d’énergie, certains professionnels de matériel de chauffage ou d’isolation peuvent proposer des prêts intéressants ou des offres particulières. Se renseigner auprès
d’eux pour plus d’information.
Dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), les fournisseurs et distributeurs d’énergie doivent permettre à leurs clients, par exemple en leur octroyant des prêts
bonifiés, de réaliser des économies d’énergie.
Les fournisseurs d’énergie (fioul domestique, gaz, électricité...) et les distributeurs (stations services...) ont vocation à participer à l’effort de réduction de la
consommation d’énergie.
Ils sollicitent les particuliers pour les inciter à adopter des technologies efficaces et à s’équiper de matériels performants leur permettant de réduire leurs consommations (électroménager
performant, isolation, matériel de régulation du chauffage, chauffe-eau solaires, pompes à chaleur...). Afin d’aider les personnes à financer ces investissements de réduction des consommations
d’énergie et répondre ainsi aux obligations que leur fixe l’État dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, certains distributeurs et fournisseurs proposent des
incitations financières : prime pour l’acquisition d’un équipement, aides aux travaux, services de pré-financement, diagnostic gratuit... des
certificats d’économies d’énergie sont alors alloués à ces acteurs économiques en contrepartie de ces actions. S’ils ne remplissent pas leurs obligations dans un certain délai, ils
devront s’acquitter d’une pénalité.
Des incitations spécifiques :
En direction des bailleurs
La contribution du locataire aux travaux d’économies d’énergie
Dans le cas de travaux d’amélioration énergétique dans un logement en location, le propriétaire peut demander au locataire une contribution aux travaux d’économie d’énergie, perçue en même temps
que le loyer : Pour cela, il faut engager une concertation préalable avec le locataire sur le contenu des travaux, leur efficacité prévue, la durée et le montant de sa contribution.
Les travaux engagés doivent permettre de réduire les charges pour le locataire et faire partie d’au moins deux des catégories de travaux éligibles définis par la
réglementation
Travaux éligibles détaillés sur le site ecocitoyens.ademe. fr/financer-mon-projet/renovation/contribution-du-locataire-aux-travaux-deconomies-denergie
Son montant sera de 10 à 20 € par mois selon le nombre de pièces (logement construit avant le 1er janvier 1948) ou limité à 50% des économies mensuelles estimées après travaux (logement construit
après le 1er janvier 1948).
Cette contribution est fixe et non révisable.
Le dispositif scellier pour certains cas de rénovation
Depuis le 1er janvier 2012, la réduction d’impôt est réservée aux logements énergétiquement performants, c’est à dire qu’elle n’est accordée qu’aux logements pour lesquels le
contribuable justifie d’un niveau supérieur de performance énergétique globale : logements neufs « BBC 2005 » ou logements anciens rénovés bénéficiant du label « BBC Rénovation », du label « HPE
Rénovation » ou respectant au moins deux exigences de performance énergétique sur quatre équipements ou matériaux, dans des conditions définies par l’arrêté du 5 mars 2012.
En direction de l’habitat collectif
Si la copropriété effectue des travaux d’économies d’énergie ou installe des équipements collectifs utilisant des énergies renouvelables, on peut bénéficier d’aides spécifiques. Pour connaître
les modalités des aides ADEME pour l’habitat collectif, se renseigner auprès de la direction régionale de l’ADEME concernée.
Il existe certaines modalités d’application spécifiques à l’habitat collectif pour le crédit d’impôt développement durable et la TVA à taux réduit. Le crédit d’impôt développement
durable s’applique aussi (voir p. 16) aux équipements réservés à l’habitat collectif (gros appareils de chauffage collectif, équipements collectifs de programmation, de régulation et de
comptage des frais de chauffage, chauffe-eau solaire collectif, chaufferie bois, production collective de chaleur ou d’eau chaude sanitaire géothermiques, raccordement à un réseau de chaleur) aux
taux précisés p. 12-13.
En tant que copropriétaire, vous pouvez percevoir le crédit d’impôt : votre syndic vous fournit une attestation précisant votre quote-part du prix d’acquisition des équipements installés et la
date du paiement des travaux
à l’entreprise qui les a réalisés. Conservez précieusement cette attestation. La TVA à taux réduit, en collectif, ne s’applique qu’à la pose pour le gros appareillage de chauffage
collectif et les équipements permettant la régulation, la programmation du chauffage, le comptage individuel et la répartition des frais de chauffage. Elle s’applique à la fourniture et à la pose
des équipements utilisant les énergies renouvelables.
Dans le neuf, construire des logements très économes en énergie est l’un des objectifs du Grenelle Environnement. Des aides sont disponibles pour équiper votre nouveau logement en utilisant les
énergies renouvelables et soutenir votre projet de construction d’un bâtiment basse consommation.
À partir de 2013, tous les logements neufs devront, pour satisfaire à la réglementation thermique, consommer moins de 50 kWh/m2 par an. Les aides financières devront donc évoluer à compter de
cette date.
En 2012, vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt développement durable pour certains équipements dans les constructions neuves. À compter du 1er janvier 2013, ce dispositif ne sera pas reconduit
pour les logements neufs. À cette date, la nouvelle réglementation thermique RT 2012 imposera une efficacité énergétique importante aux bâtiments neufs à usage d’habitation.
Une date à retenir
À compter du 1er janvier 2013, le crédit d’impôt développement durable est supprimé pour les dépenses afférentes
à un logement achevé depuis moins de deux ans.
Le logement devra donc avoir été achevé avant le 1er janvier 2011 pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt à compter du
1er janvier 2013.
Le crédit d’impôt peut être accordé dans le neuf pour l’achat de matériels utilisant les énergies renouvelables pour la production de chaleur et d’électricité (solaire, éolien, hydraulique, bois
ou autre biomasse), de pompes à chaleur et d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur. Voir article « Quid du crédit d’impôt 2012 pour financer la performance énergétique de son logement… »
![pret-taux-zero-plus-logo]()
Pour être propriétaire le PTZ+ :
Le prêt à taux zéro+ est sans intérêts, plus avantageux si vous optez pour un logement dont le niveau de performance énergétique est certifié par l’obtention du label «bâtiment basse
consommation, BBC 2005 ». Prêt sans intérêts et sans frais de dossier. Il est modulable en fonction des revenus, du nombre de personnes composant le ménage, de la zone de localisation du logement
et de sa performance énergétique.
Il ne faut pas confondre le PTZ+ qui aide à acquérir un logement et l’éco-prêt à taux zéro qui aide à rénover un logement existant.
Conditions d’obtention
- Ne pas être propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années*,
- si les revenus n’excèdent pas un plafond fonction de la localisation du logement et de la composition du ménage. Ce plafond de revenus
varie ainsi de 26 500 € (logement en zone B2 ou C avec un seul occupant) à 139 200 € (logement en zone A avec 8 occupants ou plus).
* sauf titulaire d’une carte d’invalidité correspondant au classement dans la 2e ou 3e catégorie, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée ou de
l’allocation d’éducation spéciale, victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
Le logement sera:
- la résidence principale occupée au moins 8 mois par an,
- une maison individuelle ou un appartement, Il s’agit:
- d’un logement à construire,
- d’un logement neuf jamais occupé**,
- d’un local non destiné à l’habitation, aménagé en logement,
- d’un logement existant, mais seulement pour les locataires du parc social qui acquièrent leur logement.
** à compter du 1er juin 2012, les logements qui font l’objet d’une
remise à neuf au sens de la TVA sont éligibles au PTZ+
Ce prêt ne peut faire l’objet que d’une seule demande par ménage.
Montant et durée
Son montant est calculé en appliquant un pourcentage au coût de revient TTC de l’opération (hors frais de notaire et droits d’enregistrement), dans la limite d’un plafond et ne peut excéder le
montant du ou des autres prêts d’une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l’opération. Il dépend de la localisation du logement, de son niveau de performance énergétique et de
son caractère neuf ou ancien.
|
Logement
|
Zone A
|
Zone B1
|
Zone B2
|
Zone C
|
|
Neuf, avec le label BBC 2005
|
38 %
|
33 %
|
29 %
|
24 %
|
|
Neuf, sans le label
|
26 %
|
21%
|
16 %
|
14 %
|
|
Existant, parc social *
|
10 %
|
* le prix de vente doit être inférieur de 35% au prix de l’évaluation des Domaines.
Sa durée de remboursement est comprise entre 8 et 25 ans et est fonction des revenus de l’emprunteur : plus ses revenus sont élevés, plus cette durée est courte.
L’occupation du logement
- Le logement qui a bénéficié du prêt doit être occupé par l(les)’emprunteur(s) comme résidence principale au plus tard 1 an après son achat ou son achèvement, sauf si l’achat a été fait pour
être occupé par l’emprunteur à son départ en retraite (sous réserve que ce départ intervienne au plus tard 6 ans après l’achat ou l’achèvement du logement),
- en cas de mutation professionnelle, de divorce, de dissolution de Pacs,
- en cas d’invalidité, de chômage sur plus d’un an (justificatifs exigés).
La démarche est la suivante, contacter sa banque qui appréciera les garanties de remboursement. Les documents à fournir sont notamment les avis d’imposition des 2 dernières années, éventuellement
un justificatif de l’obtention du label BBC 2005, un bail et la ou les dernière(s) quittance(s) de loyer (ou éventuellement un justificatif d’hébergement). Pour des renseignements supplémentaires
ou pour faire établir un plan de financement, consulter une ADIL ou les établissements de crédit conventionnés.
![Habiter mieux]()
Le dispositif Scellier :
Destiné aux investisseurs et encourage l’achat de logements dont le niveau de performance énergétique est certifié par l’obtention du label «bâtiment basse consommation, BBC 2005 ».
Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour l’achat d’un logement destiné à la location. (entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
2012) Pour mieux connaître ce dispositif, consulter une ADIL, les sites www.anil.org ou vosdroits.service-public.fr.
Pour en bénéficier, il faut être fiscalement domicilié en France. On ne peut en bénéficier que pour l’achat ou la construction d’un seul logementdans une même année par foyer fiscal. On peut être
une personne physique ou une SCI* soumise à l’impôt sur le revenu.
Le logement doit être
- neuf, porteur du label BBC 2005 **,
- loué non meublé comme résidence principale pendant au moins 9 ans, sous plafond de loyers,
- situé dans certaines zones du territoire ***,
Il peut être
- acheté neuf ou en l’état de futur achèvement,
- construit par le contribuable, transformé (locaux transformés en logements), réhabilité ou remis à neuf ****.
* SCI, société civile immobilière.
** pour un logement existant, voir page 31
*** zones A, B1 et B2 de l’arrêté du 29 avril 2009.
**** le champ des logements éligibles a été légèrement étendu par la loi de finances pour 2012, il ne s’agit alors que des logements pour lesquels la demande de
permis de construire a été déposée après le 1er janvier 2012.
Le locataire :
- ne doit pas faire partie de votre foyer fiscal,
- doit habiter le logement au plus tard 1 an après l’achat ou l’achèvement des travaux.
Le montant :
- est accordé dans la limite de 300 000 € par logement pris en compte, dans la limite d’un prix au m2.
Les taux sont de :
13% pour les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2012 *. L’avantage fiscal peut être renforcé si les revenus du locataire sont inférieurs à
des plafonds de ressources, et que le loyer se situe en dessous de plafonds spécifiques au «Scellier intermédiaire».
Par ailleurs, le taux du complément de réduction d’impôt accordé aux investissements dont la location reste consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale de l’engagement de
location est de 4 % du prix de revient du logement par période triennale.
Dans les mêmes conditions, on peut bénéficier de la réduction d’impôt Scellier pour la souscription des parts de SCPI **.
* pour les permis de construire déposés avant le 31 décembre 2011, voir l’article 199 septvicies du code général des impôts et le rescrit (RES n° 2012/4(FP)),
publié le 14 février 2012 sur le « portail fiscal » (impots.gouv.fr) pour les taux applicables.
** SCPI société civile de placement immobilier.
 How Much
does your Building Weigh, Mr Foster ? – 16 mai 2012-
How Much
does your Building Weigh, Mr Foster ? – 16 mai 2012-


 Pensée du Jour
Pensée du Jour
 Court-circuité le Linky ???
Court-circuité le Linky ???
 La Rive Gauche se pare de deux nouvelles tours « DUO » signées par
La Rive Gauche se pare de deux nouvelles tours « DUO » signées par 

 L’écologie au cœur de la campagne présidentielle
de 2012 ???
L’écologie au cœur de la campagne présidentielle
de 2012 ???
 Concours 2012 pour les Infrastructures pour la Mobilité et Biodiversité
Concours 2012 pour les Infrastructures pour la Mobilité et Biodiversité
 ‘BIOMIMETISME - QUAND LA
NATURE INSPIRE DES INNOVATIONS DURABLES’ Janine M. BENYUS
‘BIOMIMETISME - QUAND LA
NATURE INSPIRE DES INNOVATIONS DURABLES’ Janine M. BENYUS
 Empreintes - Anne Lauvergeon, l’art de dire non - Vendredi 11 mai 21.30-France 5
Empreintes - Anne Lauvergeon, l’art de dire non - Vendredi 11 mai 21.30-France 5
 Pensée du
Jour
Pensée du
Jour
 Quelles
sont les régions les plus qualifiées dans les énergies renouvelables ???
Quelles
sont les régions les plus qualifiées dans les énergies renouvelables ???
 Villavenir + Atlantique, lancement des travaux pour 3 modes constructifs en BEPOS
Villavenir + Atlantique, lancement des travaux pour 3 modes constructifs en BEPOS



 Quid du crédit
d’impôt 2012 pour financer la performance énergétique de son logement…
Quid du crédit
d’impôt 2012 pour financer la performance énergétique de son logement…
 Après le crédit d’impôt, quoi
d’autres ???
Après le crédit d’impôt, quoi
d’autres ???



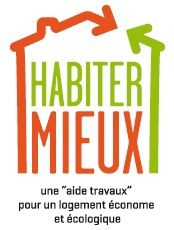
 L’art de bâtir avec le bioclimatisme
…
L’art de bâtir avec le bioclimatisme
…

 © P.Wickramasinghe
© P.Wickramasinghe
 Léonard de Vinci - L'énigme de "La Belle Princesse" - SAMEDI 5 MAI 2012 À 20.45 - ARTE
Léonard de Vinci - L'énigme de "La Belle Princesse" - SAMEDI 5 MAI 2012 À 20.45 - ARTE
 Pensée du
Jour
Pensée du
Jour 1WTC dans la Skyline de New
York…
1WTC dans la Skyline de New
York…


 Le DPE imposé pour les centres commerciaux …
Le DPE imposé pour les centres commerciaux …
 Quel influence l’architecte a-t-il pour le choix des produits de la construction ?
Quel influence l’architecte a-t-il pour le choix des produits de la construction ?