 Le 25 mai, la Journée Citoyenne pour être au cœur des décisions sur l’avenir de notre modèle énergétique.
Le 25 mai, la Journée Citoyenne pour être au cœur des décisions sur l’avenir de notre modèle énergétique.
Donner la parole aux acteurs peu écoutés, à tous les citoyens invités à débattre directement des enjeux énergétiques.
Ainsi, l’objectif de la Journée citoyenne est de constituer dans chaque territoire un panel de 100 à 150 citoyens qui reflètent au mieux la diversité de la population régionale et tiennent compte de sa géographie.
Les citoyens sont recrutés par des instituts de sondage mandatés par les Conseils régionaux afin de garantir la neutralité nécessaire à la démarche. Le recrutement répond à un cahier des charges unique comptant sept critères, dont certains ont trait particulièrement à l’énergie (type d’habitat, mobilité .... ).
L’objectif du panel est de pouvoir faire discuter des citoyens dont «l’expérience énergétique » se révèle différente selon :
- leur âge : certains auront connu les chocs pétroliers et la « chasse au gaspi »,
- leur lieu d’habitation : certains auront déjà abandonné leur véhicule personnel pour les transports collectifs, quand d’autres, éloignés des villes, pourront exprimer leur manque d’alternative,
- leur façon de consommer : certains plaideront pour une consommation responsable et en circuits-courts, quand d’autres pourront dire leur attachement aux grandes surfaces.
Catégorie socioprofessionnelle des individus : répartition d’ouvriers, d’employés, de catégories intermédiaires, de cadres, de retraités, de chômeurs et d’inactifs ;
Sexe : parité hommes et femmes ;
Classes d’âge : équilibre des âges entre 18 à 60 ans et plus ;
Origine géographique et type d’agglomération : contextes résidentiels différenciés.
Type d’habitat et statut d’occupation : propriétaires d’une maison individuelle ou d’un appartement locataires, en habitat social ou en habitat privé ;
Structure du foyer : personnes en couple, sans enfants, en couple avec enfants, seules ;
Mode de transport : voiture, transports en commun, à pied, temps de trajet quotidien (long, moyen, court).
Pour la première fois, des centaines de citoyens vont être réunis simultanément dans plusieurs régions pour débattre sur les mêmes questions et selon la même méthodologie. Cette démarche innovante s’appuie sur la diversité des citoyens et des territoires au moment où il faut faire des choix importants pour le pays.
La Journée citoyenne relève d’un exercice national de consultation citoyenne réalisé pour la première fois en France à cette échelle. Le même jour, dans 14 régions, des citoyens vont débattre et donner leur avis selon un protocole identique.
La mise en œuvre de cette Journée s’appuie sur la mise en place d’un partenariat étroit avec les conseils Régionaux. Ce partenariat est porteur de sens à double titre :
- l’échelon régional est un levier de la transition énergétique du fait de la capacité des territoires à innover et expérimenter des solutions ;
- les Régions sont fortes d’un savoir-faire à conduire des dynamiques d’actions avec la société civile, les citoyens, les chefs d’entreprises, les universités, centres de formations, les autres collectivités locales. Et les services déconcentrés de l’Etat...
Lors de la Journée citoyenne du 25 mai, 1000 à 1500 citoyens vont participer au débat national, dans 14 Régions différentes. Les citoyens vont vivre un même déroulement, recevoir les mêmes informations, selon le même protocole.
La démarche permet aux citoyens de s’approprier les enjeux de la transition énergétique afin qu’ils puissent se positionner sur les 4 grandes questions du débat et donc donner un point de vue éclairé, contrairement à un sondage d’opinion.
La Journée citoyenne s’appuie sur le protocole des rencontres World Wide Views, développé et promu dans le monde par le Danish Board of Technology, équivalent danois de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologique (OPECST).
Le déroulement de la Journée citoyenne suit le même protocole et s’articule autour de 4 séquences d’une heure chacune, construites de la même manière.
• Livret 1 : Pourquoi s’engager dans la transition énergétique, aujourd’hui ?
Ce premier livret explique pourquoi la transition énergétique est nécessaire, et pourquoi aujourd’hui : en quoi la situation énergétique actuelle de la France appelle ce changement de nos modes de consommation et de production d’énergie, quelles sont les orientations à prendre et les engagements pris.
• Livret 2 : Comment agir sur la consommation des énergies ?
Ce deuxième livret explore la question de la maîtrise de la demande d’énergie : comment pouvons-nous agir sur nos consommations d’énergie ? En quoi consiste une politique allant dans ce sens ? Jusqu’où peut-elle aller et quelles questions pose-t-elle ?
• Livret 3 : Quel chemin prendre pour la transition énergétique ?
Ce troisième livret porte sur les choix à faire en matière de trajectoire énergétique, c’est-à-dire sur le chemin que nous voulons suivre pour mener cette transition. Il fait le lien entre nos choix en matière de consommation d’énergie et les options dont nous disposons sur la production d’énergie. Il liste les principaux critères à intégrer dans ces décisions.
• Livret 4 : Comment pouvons-nous concrètement mettre en œuvre la transition énergétique ?
Ce quatrième livret aborde les aspects de mise en œuvre concrète de la transition énergétique : comment s’assurer de la cohérence des décisions, à quelle échelle est-il le plus pertinent d’agir ? Quel rôle donner aux citoyens dans cette politique, et comment assurer la juste répartition des efforts et des bénéfices ?
Rédigés par le Secrétariat général du débat, les livrets ont fait l’objet de multiples consultations afin que l’information soit « exacte, adéquate et équilibrée » selon les exigences de la méthode.
Un Comité de relecture scientifique a été constitué pour vérifier la rigueur et l’exactitude des informations fournies. Ce comité a été formé au sein du Groupe des experts constitué pour le Débat. Ont participé à cette relecture : Michel COLOMBIER, directeur scientifique de l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales), Dominique DRON, ingénieure générale des Mines, Alain GRANDJEAN, président du Groupe des experts, directeur associé de Carbone 4, Gérard MAGNIN, délégué général d’Energy Cities, François MOISAN, directeur scientifique de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), Cédric PHILIBERT, expert de l’AIE, Cyril ROGER-LACAN, directeur de Tilia-Umwelt, Thierry SALOMON, président de NégaWatt.
A l’issue de cette journée, l’expression des citoyens sera synthétisée et analysée aussi bien au niveau régional que national. La centralisation des résultats sera réalisée au fur et à mesure de la Journée permettant d’établir une cartographie précise des attentes et opinions des citoyens.
Les citoyens sont amenés à prendre position sur l’ensemble des aspects du débat à travers différentes séquences thématiques. Les enseignements de la Journée devraient permettre de donner des informations sur :
- La manière dont les enjeux de la transition énergétique sont compris par les citoyens
- La manière dont les citoyens se projettent ou non dans les choix énergétiques
- Le soutien dont ils souhaitent bénéficier, les freins qu’ils rencontrent pour agir
- Les éléments porteurs d’un nouveau modèle auquel les Français pourraient le mieux adhérer
- Qu’est –ce que les citoyens attendent en priorité d’une loi sur la transition énergétique ?
Les principaux enseignements seront disponibles le soir du 25 mai au niveau national et dans chaque région engagée. Ces résultats seront également accessibles en ligne sur le site Internet du débat national sur la transition énergétique : www.transition-energetique.gouv.fr
Tous les éléments produits dans le cadre des débats régionaux, y compris la voix des citoyens à travers la Journée citoyenne, seront pris en compte dans la synthèse qui sera produite par le Conseil national et dans les synthèses régionales.
Au Conseil national du 20 juin sera présentée la vision citoyenne issue de la Journée citoyenne, du Comité citoyen et des contributions postées sur le site Internet du débat.
Les recommandations qui résulteront de ce grand débat national serviront de base au projet de loi de programmation pour la transition énergétique, que le gouvernement présentera à l’automne.
 « piscine protégée, faut quand même me surveiller »
« piscine protégée, faut quand même me surveiller »

 Biocarburant à partir de micro-algues, moteur
Biocarburant à partir de micro-algues, moteur VueS d’en haut
VueS d’en haut Robert Delaunay, Tour Eiffel et jardins du Champ-de-Mars,
1922-Huile sur toile, 178,1 × 170,4 cm - © Smithsonian Institution, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washigton, D.C. © The Joseph H. Hirshhorn Bequest, 1981 / Photo : Lee
Stalsworth
Robert Delaunay, Tour Eiffel et jardins du Champ-de-Mars,
1922-Huile sur toile, 178,1 × 170,4 cm - © Smithsonian Institution, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washigton, D.C. © The Joseph H. Hirshhorn Bequest, 1981 / Photo : Lee
Stalsworth
 Vassily Kandinsky, Akzent in Rosa [Accent en rose], 1926-Huile
sur toile, 100,5 x 80,5 cm-Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris © ADAGP, Paris 2013 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat
Vassily Kandinsky, Akzent in Rosa [Accent en rose], 1926-Huile
sur toile, 100,5 x 80,5 cm-Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris © ADAGP, Paris 2013 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat
 Theo van Doesburg, Composition X, 1918-Huile sur toile, 64 x 45
cm-Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat
Theo van Doesburg, Composition X, 1918-Huile sur toile, 64 x 45
cm-Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

 Tullio Crali, In tuffo sulla città [En piqué sur la ville],
1939-Huile sur toile, 130 x 155 cm © Museo d’arte moderna e contemporaneo di Trento e Rovereto, Rovereto
Tullio Crali, In tuffo sulla città [En piqué sur la ville],
1939-Huile sur toile, 130 x 155 cm © Museo d’arte moderna e contemporaneo di Trento e Rovereto, Rovereto
 Jackson Pollock, Painting (Silver over Black, White, Yellow and Red) [Peinture
(Argent sur noir, blanc, jaune et rouge)], 1948-Peinture sur papier marouflé sur toile, 61 x 80 cm-Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris © ADAGP, Paris 2013 ©
Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat
Jackson Pollock, Painting (Silver over Black, White, Yellow and Red) [Peinture
(Argent sur noir, blanc, jaune et rouge)], 1948-Peinture sur papier marouflé sur toile, 61 x 80 cm-Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris © ADAGP, Paris 2013 ©
Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat
 Ed Ruscha, Wen Out for Cigrets [Sorti ach’ter des cig’rettes],
1985-Huile et émail sur toile, 162,6 ×162,6 cm-© Collection Sylvio Perlstein, Anvers (Belgique) © Ed Ruscha
Ed Ruscha, Wen Out for Cigrets [Sorti ach’ter des cig’rettes],
1985-Huile et émail sur toile, 162,6 ×162,6 cm-© Collection Sylvio Perlstein, Anvers (Belgique) © Ed Ruscha
 Mishka Henner, Nato Storage Annex, Coevorden, Drenthe, 2011-Archival
giclée prints, 80 × 90 cm-Centre Pompidou, Musée national d'art moderne © Mishka Henner
Mishka Henner, Nato Storage Annex, Coevorden, Drenthe, 2011-Archival
giclée prints, 80 × 90 cm-Centre Pompidou, Musée national d'art moderne © Mishka Henner

 Un
principe constructif Bois/Paille simple et économique, la résidence Jules Ferry à Saint-Dié-des-Vosges
Un
principe constructif Bois/Paille simple et économique, la résidence Jules Ferry à Saint-Dié-des-Vosges









 JOURNÉE SPÉCIALE ARCHÉOLOGIE - SAMEDI 8 JUIN 2013 SUR ARTE
JOURNÉE SPÉCIALE ARCHÉOLOGIE - SAMEDI 8 JUIN 2013 SUR ARTE
 Pensée du Jour
Pensée du Jour Journée citoyenne sur la Transition énergétique, quelles
leçons .... ?
Journée citoyenne sur la Transition énergétique, quelles
leçons .... ?
 Le CO2, un nouveau passager
clandestin….
Le CO2, un nouveau passager
clandestin….
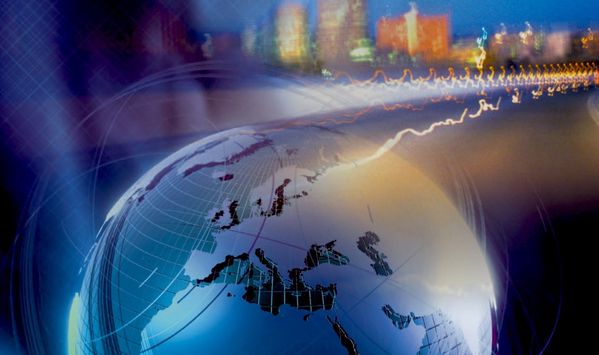 La politique européenne en matière d’efficacité
énergétique dans le brouillard…
La politique européenne en matière d’efficacité
énergétique dans le brouillard…
 Avis favorable au déploiement d'une ferme expérimentale hydrolienne dans le
Fromveur
Avis favorable au déploiement d'une ferme expérimentale hydrolienne dans le
Fromveur

 L’écologisation des recettes municipales peut grandement favoriser une trajectoire de
croissance plus durable.
L’écologisation des recettes municipales peut grandement favoriser une trajectoire de
croissance plus durable.
 11
11 Pensée du Jour
Pensée du Jour
 Les ports français,
Les ports français,
 Les maires
tiennent à garder leur PLU…
Les maires
tiennent à garder leur PLU…
 Syndics de copropriétés obscurs …
Syndics de copropriétés obscurs …
 Solution préfabriquée pour la réalisation des parois verticales en béton armé et des planchers en béton pour un hôtel à Nantes…
Solution préfabriquée pour la réalisation des parois verticales en béton armé et des planchers en béton pour un hôtel à Nantes…




 READY
READY  © Bas Jan Ader, Fall I, 1970 Courtesy Museum Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam
© Bas Jan Ader, Fall I, 1970 Courtesy Museum Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam
 © Bas Jan Ader, Broken Fall (geometric), 1971 Courtesy Museum Boijmans
Van Beuningen, Rotterdam
© Bas Jan Ader, Broken Fall (geometric), 1971 Courtesy Museum Boijmans
Van Beuningen, Rotterdam
 © Taiyo Onorato & Nico Krebs, Happy Ending, 2005, série The Great
Unreal Courtesy RaebervonStenglin, Zurich
© Taiyo Onorato & Nico Krebs, Happy Ending, 2005, série The Great
Unreal Courtesy RaebervonStenglin, Zurich
 © Taiyo Onorato & Nico Krebs, Basilicata – Quarry 1, 2011, série
Constructions Courtesy Aargauer Kunsthaus, Aargau
© Taiyo Onorato & Nico Krebs, Basilicata – Quarry 1, 2011, série
Constructions Courtesy Aargauer Kunsthaus, Aargau
 © Taiyo Onorato & Nico Krebs, Abbyss, 2006, série The Great
Unreal FNAC 2011-0526, Centre National des Arts Plastiques
© Taiyo Onorato & Nico Krebs, Abbyss, 2006, série The Great
Unreal FNAC 2011-0526, Centre National des Arts Plastiques